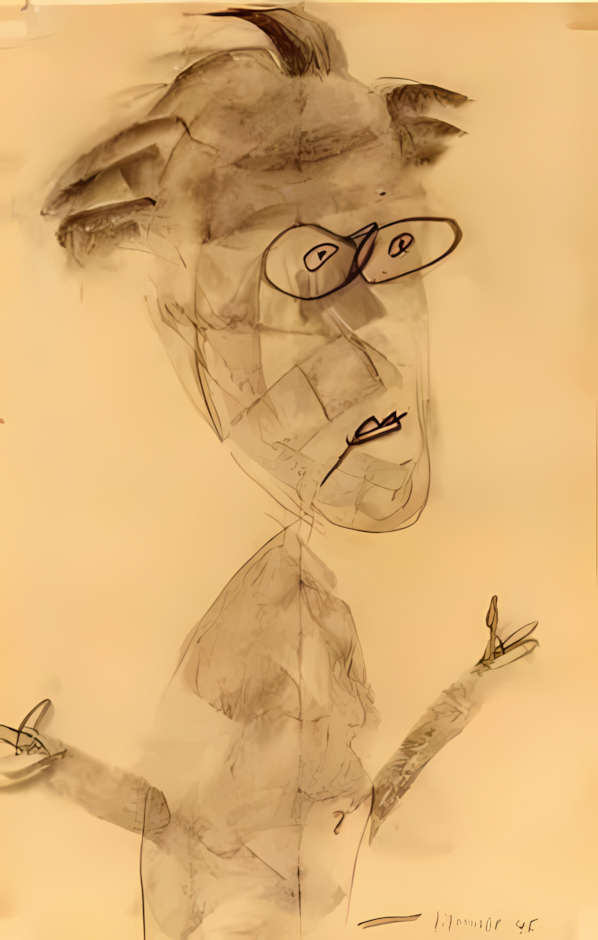Lauréat du prix Femina en 1955 pour Le pays où l’on n’arrive jamais , André Dhôtel n’a jamais revendiqué sa foi catholique dans ses écrits. Une « ligne de fuite » semble caractériser ceux-ci : des horizons sans cesse reculés, des personnages entretenant un dialogue avec eux-mêmes sans redouter l’échec, des lieux « déshérités » et des « chemins perdus » composant un univers romanesque imprégné de mystère et de lumière.
Un écrivain catholique ?
« André ne se considère pas comme un écrivain catholique. Écrivain, oui. Catholique, bien sûr et collaborateur de La Croix. Mais l’association [des deux mots, NDLR] ne lui sourit pas » (Suzanne Briet)1.
« Je n’ai pratiqué ma religion qu’à 37 ans… les obligations chrétiennes sont une épreuve de vie infiniment plus grave que toute littérature », lui répond en écho le romancier dans un entretien à la revue Le Pèlerin, en 1961. On ne lui a pas connu le moindre engagement militant. De parents libres penseurs, il s’était converti pour épouser religieusement Suzanne Laurent en 1932, et fut fortement influencé par le curé « qui ne parlait de religion en aucun cas et convertissait les gens sans le faire exprès ».
« Pas une seule page où apparaisse quelque thèse, quelque morale, une de ces profondes méditations dont se régalent tant d’écrivains contemporains », écrit à propos de l’œuvre d’André Dhôtel le critique Philippe Jaccottet2. Si ses œuvres ne ne laissent pas transpirer de recherche ou d’énoncés à caractère religieux, elles sont pourtant tout imprégnées de spirituel, tant dans son attirance contemplative pour la nature que dans son talent à décrire les émotions et les mouvements de l’âme de ses personnages, environnés d’un univers romanesque pétri de secrets.
Les êtres simples
André Dhôtel déclarait lui-même : « Ce qui m’a souvent guidé, ce qui m’a incité à écrire (…), c’est la rencontre d’êtres simples et que je trouvais merveilleux. Pour peu qu’on veuille bien parler, échanger, écouter – j’aime écouter -, on se met en état de découvrir en chaque vie tout un monde. » Et Jean Paulhan de commenter : « Ce sont les aventures de la vie toute nue qui lui viennent, et à nous avec lui. »
Ces jeunes gens et jeunes filles modestes ne sont à la recherche ni de la gloire, ni de la richesse, mais d’une lumière, plus simplement encore des signes faibles d’un monde lointain, inconnu mais pas étranger, l’étrangeté même étant signe de sacré.
Ces vies qui passent inaperçues témoignent d’une « soumission, non pas servile, mais naturelle, à l’ordre du monde » (Philippe Jaccottet).
« Cette magnifique ombelle, aussi bien du poison, naissait d’une graine certes plus volumineuse que le grain de moutarde de l’Évangile, mais elle n’avait pas la moindre raison d’exister et de se dépenser en ses fioritures qui se balancent vainement dans l’air. Et lui, Florent, n’avait pas en ce monde une place mieux marquée que l’ombelle. Il était donc là chez lui sous ces ombrages de saules malingres, dans l’humide fouillis d’herbes folles (Histoire d’un fonctionnaire).
Georges Limbour résume, à l’adresse de l’écrivain, en octobre 1964 : « Tu as créé une grande famille de personnages qui portent au cœur la même blessure dans l’esprit, non la révolte, mais un refus innocent de ce monde, avec la connaissance profonde de celui qui lui serait préférable.Tu as inventé ta géographie, tes villages et tes campagnes que tu as rendus perceptibles à tous les sens – humidité des feuilles, odeur de la sciure de bois – et ta cartographie de sentiers et de routes, de plats et de ravins, où l’on se perd, se cherche et se retrouve sans jamais cependant atteindre l’indicible but. »
Un vrai contemplatif
Le ciel, la forêt, les plantes, les fleurs et les arbres composent un décor précis mais familier à tout lecteur : c’est la nature dans sa force et sa simplicité, dont la contemplation est une leçon de vie. « Il y a dans la nature une intelligence qui n’est pas la nôtre. »
« Sans même le savoir il avait la conviction que tout ce qui ferait sa vie lui serait donné par la forêt. Il y a dans les bois une grande paix fraternelle » (Le pays où l’on n’arrive jamais).
André Dhôtel n’invente rien de la nature qu’il a tant fréquentée dans la modeste campagne des Ardennes, en allant à la cueillette des champignons « ambigus et radieux » et des pommes, en allant pêcher en barque, et, souvent en ne faisant rien. « On regarde et on attend », explique-t-il dans une correspondance à Henri Thomas, « on se chauffe au soleil, en regardant la rivière tout le long des après-midi ». Mais l’écrivain voit la nature différemment, et il en fait entrevoir le mystère :
« Sous les peupliers, parmi les arbustes et les herbes, il y avait un soudain rayonnement. Pas fait avec des rayons de lumière, mais comme si plusieurs pistes à peine plus larges que des sentiers se divisaient autour de lui, ne menant nulle part en réalité, plutôt avec le soupçon indicible de quelqu’un qui allait venir, ou bien quelqu’un qui était déjà venu peut-être et qui reviendrait. (…) Ombre ou lumière, il y avait ici ce qui est autre. Pas une présence comme pour les poètes, mais un simple passage, celui de l’inimaginable en ces pistes divisées sous les peupliers parmi les arbustes et les herbes. Un seul arbre déjà, c’est l’inimaginable puisqu’il s’agit d’une vie absolument aberrante pour nous. Or dans ces espaces régnait une vie éclatante. Il ne pouvait rien définir sinon qu’il touchait à ce qui lui manquait. En sa conviction de minime individu, Florent fut enclin à supposer qu’il y avait quelque part à découvrir une réalité qui dépassait toute attente » (Histoire d’un fonctionnaire).
Saint Benoît Joseph Labre : sur la piste du sacré
Ce livre fut écrit en 1956 juste après l’attribution du prix Femina au Pays où l’on n’arrive jamais. Cette biographie est une commande des éditions Plon qui, pour leur collection « Hommes de Dieu », demandèrent des biographies de saints à des écrivains non spécialisés dans la littérature religieuse.
Le choix de ce saint peu connu n’est pas fortuit : André Dhôtel était fasciné par ceux qui « ignorent les commodités de la terre », comme Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine, et définissait le pèlerinage comme « un voyage où l’on ne propose pas un but, mais une absence de but ».
Benoît Joseph Labre fut un marcheur, « un frère plus pur et plus absolu » des héros d’André Dhôtel selon Philippe Jaccottet, qui y voit « une œuvre qui n’est pas religieuse au sens habituel du mot, sans processions, ni prêtres déchirés par le doute ».
Né à Amettes (Pas-de-Calais) en 1748, fils de paysans, proche de deux oncles prêtres, Benoît Joseph ne put apprendre le latin ni s’adapter à aucun ordre religieux malgré ses tentatives (les Chartreuses de Sainte-Aldegonde et de Notre-Dame-des-Prés, les Trappes de Soligny et Sept-Fons3 ). Il s’en fut donc seul sur les routes avec un livre de prières, vivant d’hospitalité et de mendicité, dépouillé de tout sentiment personnel « sauf celui d’être indigne », et durant son périple sur les pas de grands saints, se complut « dans une solitude éblouissante d’où on ne pouvait le déloger », « hanté par les âmes perdues », ne voulant surtout pas être pris pour un saint, mais devenir « le dernier des hommes pour témoigner de la plus grande lumière » (André Dhôtel). Cette route le mena de Sept-Fons (Allier), à Paray-le-Monial puis dans le Piémont italien, à Bologne, Ravenne, Ancône, Assise, Naples et Bari, ensuite en Espagne pour finir par la Suisse et Rome, fuyant dès qu’il accomplissait des prodiges. André Dhôtel définit son errance dans un extrême dénuement comme « une longue approche des lieux sacrés ». À l’église d’Amettes, on peut voir les reliques du saint qui sont à son image : une paillasse, un livre de prières, une chaussure sans semelle, une savate en toile élimée – les biens d’un homme qui pria si souvent à genoux, qui parcourut plus de 30 000 km en Europe et mourut à l’âge de trente-cinq ans. Au cours de ce périple épuisant, plusieurs confesseurs s’émurent de voir un homme jeune livré à cette « misère insensée », rappelle André Dhôtel.
Les trois cœurs de Benoît Joseph Labre : « Les trois cœurs qu’il faut garder : le cœur plein de douceur pour tous les hommes, son propre cœur d’une dureté absolue pour soi-même, et le cœur de feu pour son Dieu. » Et ses pages préférées dans l’ouvrage du P. Lejeune (1592-1672) qui ne le quittait pas : « Vous ne sauriez prier, si Dieu ne vous ouvre la bouche. Vous ne pouvez rien demander au nom de votre Sauveur, si le Saint-Esprit ne prie en vous. Vous ne sauriez avoir la volonté de prier si Dieu ne vous la donne par sa miséricorde. »
« La seule cause pourquoi nous ne sommes pas secourus de Dieu, c’est qu’il y a toujours dans notre cœur quelque grain de défiance. »
« Je crains le fond du cœur où personne ne peut lire, que Dieu : les péchés intérieurs, l’orgueil secret, la présomption de nous-mêmes, la confiance en nos vertus prétendues, l’attachement à nos pensées, à nos sentiments, à nos intérêts. »
André Dhôtel, qui a suivi quelques étapes de la longue piste de Benoît Labre, finit par se passionner pour son sujet et se sentir très familier de ce personnage dont « la démarche inlassable et rêveuse témoigne d’une beauté continuée, à retrouver dans la nuit, où que ce soit et pour tous, jusqu’au bout du monde».
Il y a en somme moins de religieux que de sacré dans l’œuvre d’André Dhôtel, paisible dans sa certitude qu’ « il n’y a dans le monde que des choses gâchées au milieu d’une magnificence impossible à saisir» et que « nous ne sommes pas abandonnés. Quelqu’un veille sur nous, avec nous ». Il a assigné à la littérature, et d’abord à la sienne propre, de rappeler « combien notre situation est désespérée, combien notre espérance est incroyable, et que c’est l’incroyable qui nous est nécessaire comme tel, et nous amène à la pratique la plus humble de la prière qui est la reconnaissance de notre nuit et l’attente d’une lumière hors de mesure, d’autant plus belle que nous n’étions rien4 ».
Le Dieu d’André Dhôtel est moins dans les églises que dans la nature, dans ces sous-bois énigmatiques, ces sentiers de pèlerinage vers le pays où l’on arrive un jour.
www.andredhotel.org (Association des Amis d’André Dhôtel, 10-12, rue de Reims 75013 PARIS)
Article publié dans la revue Una Voce n°349 de Novembre – Décembre 2024
- Suzanne Briet, « André mon cousin, Journal ardennais », Cahiers André Dhôtel n° 17, novembre 2019.↥
- « Avec André Dhôtel, Choix de textes critiques », Éditions Fata Morgana, 2008.↥
- Où il fut la proie de graves crises d’angoisse qui mirent fin à son noviciat.↥
- « La littérature et le hasard » (notes écrites entre 1942 et 1945, rassemblées par Philippe Blondeau), Éditions Fata Morgana, 2015.↥