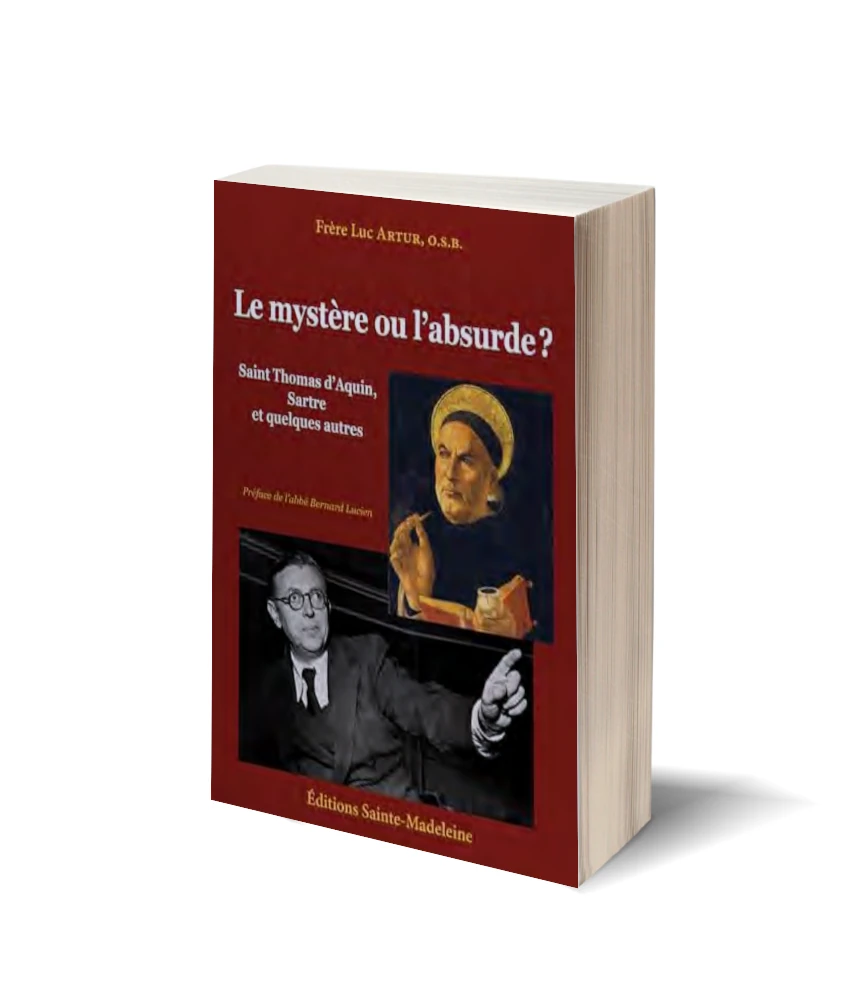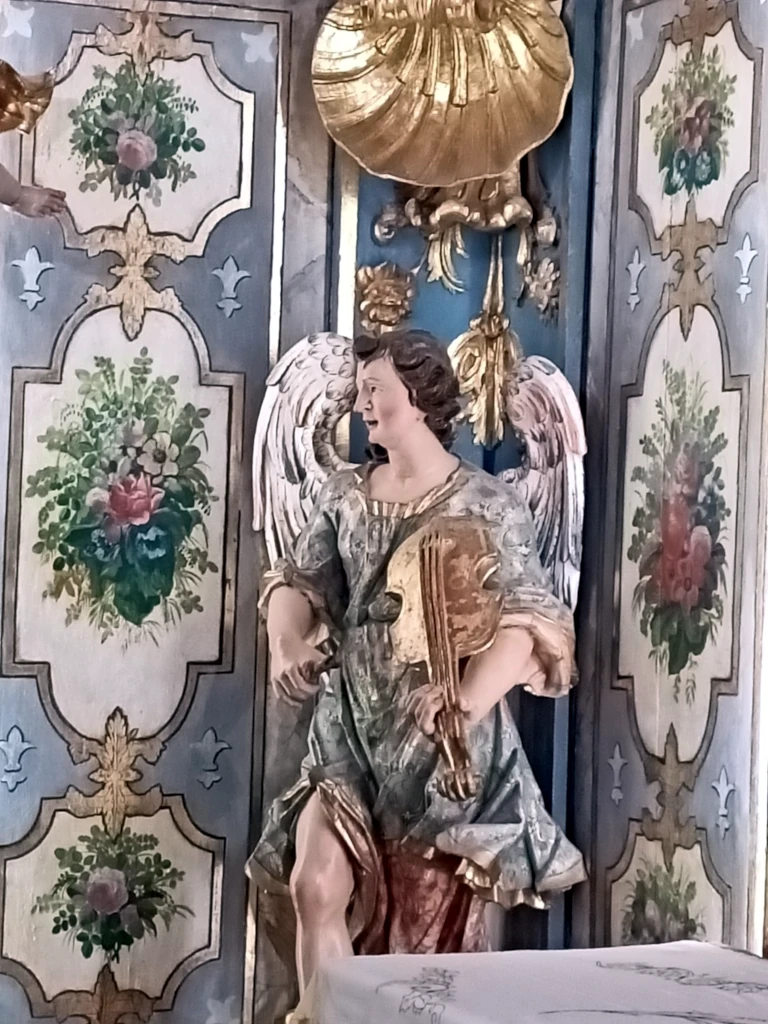Les collections de l’Italie du Nord ont conservé un assez grand nombre de manuscrits liturgiques à l’usage des églises de rite ambrosien, dont les plus anciens sont du Xe siècle. « Il fallait jusqu’à présent une bonne volonté peu commune pour s’occuper d’une liturgie et d’un champ que les Milanais semblaient avoir pris à tâche de tenir à l’abri des regards étrangers », écrit Louis Duchesne en 1920 dans son « Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne ».
Des bibliothèques prestigieuses et riches
Les sacramentaires ne contiennent que les prières sacerdotales, à l’exclusion des lectures et des parties chorales. Les antiphonaires sont réservés aux parties chantées. La plupart des sacramentaires et antiphonaires de la liturgie ambrosienne sont conservés dans l’une des quatre grandes bibliothèques de Milan :
La bibliothèque ambrosienne
La bibliothèque ambrosienne a été fondée par le cardinal-archevêque de Milan Federico Borromeo (1564-1631) en septembre 1607 et ouverte au public en décembre 1609. La salle de lecture publique appelée « Sala federiciana », ouverte à ceux qui savaient lire et écrire, fut une des premières de son genre en Europe.
Le cardinal Borromeo avait pour ambition de créer un centre d’études et culture à Milan conçu comme un « temple des muses » pour promouvoir les valeurs humaines et chrétiennes à travers la science et la culture, au service de l’église catholique.
Il envoya donc des agents à travers l’Europe occidentale jusqu’en Grèce, puis en Syrie pour acquérir des manuscrits et des livres imprimés de toutes les cultures existantes : la bibliothèque a commencé avec environ 15.000 manuscrits (dont les manuscrits complets du monastère bénédictin de Bobbio en 1606) et 30.000 livres imprimés, et a reçu en 1608 la bibliothèque de 800 manuscrits de l’humaniste padouan Vincenzo Pinelli. Elle comporte une innovation majeure pour l’époque : les livres étaient rangés dans des étagères le long des murs plutôt que d’être enchaînés à des tables de lecture.
Avec la pinacothèque fondée en 1618 et l’académie des beaux-arts en 1620, L’Ambrosiana est ainsi devenue un centre culturel complet.
La bibliothèque trivulzienne
Elle est issue de la collection privée de la famille Trivulzio constituée au XVIIIe siècle et a été acquise par la ville de Milan en 1935. Malgré des dommages subis lors de bombardements en août 1943, elle abrite plus de 1300 manuscrits et autant d’incunables ainsi que de nombreuses éditions du XVIe siècle. Les ouvrages les plus célèbres sont la collection complète des éditions du XVe siècle de la divine comédie de Dante, et le codex trivulzianus de Léonard de Vinci de 1490. Abritée dans le château des Sforza, elle est ouverte au public et comporte depuis 1978 un atelier de restauration de manuscrits.
Bibliothèque du Chapitre
Située dans le palais des chanoines, c’est la plus ancienne bibliothèque publique de Milan, fondée probablement en même temps que la cathédrale afin d’abriter des livres liturgiques et autres publications nécessaire au Chapitre. C’est pourquoi elle contient 500 manuscrits, 68 incunables et près de 1000 cinquecentine (livres imprimés au XVIe siècle). Les manuscrits ambrosiens d’un grand intérêt pour l’histoire de l’enluminure constituent la plus grande partie de son patrimoine de codex, certains remontant au IXe siècle.
Bibliothèque Brera
Elle a été fondée en 1170 dans le palais Brera, un bâtiment construit par les jésuites au 17e siècle, par Marie-Thérèse d’Autriche qui souhaitait rendre que la collection de livres de Carlo Pertusati acquise par l’archiduc Ferdinand. Elle possède une collection de plus de 1,5 million de volumes, dont des manuscrits, des incunables et des cinquecentine.
Basilique Saint Ambroise
Construite par Saint Ambroise à la fin du IVe siècle dans le style roman Lombard, elle a été construite sur un cimetière de martyrs, d’où son nom initial de basilica martyrum. M décorez de mosaïque byzantine, elle possède un autel d’or du IXe siècle dont les reliefs représentent des scènes de la vie de Saint Ambroise et du Christ.
Inventaire des livres ambrosiens : un travail de Bénédictin
Léopold Delisle, dans son Mémoire de 1886, énumère successivement les sacramentaires de Monza , de Biasca, de Lodrino, d’Héribert ou de S. Satyre1, de S. Simplicien, d’Armio, du marquis Trotti et enfin le cod. Ambros. T. 120 sup soit huit manuscrits qui sont certainement parmi les plus anciens que l’on connaisse.
Dix-sept ans plus tard (1903), Paul Lejay, inaugurant le « Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie » de Cabrol, reprenait à son propre compte la nomenclature de Delisle, tout en omettant, pour une raison que l’on ne peut deviner, le codex Trotti et en lui substituant le sacramentaire de Bergame que venait de publier Dom Cagin de Solesmes (1847-1923).
Le liturgiste milanais Antonio Ceriani, cheville ouvrière de la révision du Missel ambrosien entreprise en 1902, n’avait pas pu mener à bien l’inventaire complet des missels ambrosiens manuscrits, mais avait laissé un important corpus de notes, publiées en 1913, six ans après son décès2. Ceriani mit en valeur et en première position des livres ambrosiens le sacramentaire de Biasca et, celui-ci étant pris comme base, il lui a comparé les sacramentaires ou missels de Trotti, de Lodrino, de Bedero, d’Héribert, du cod. Ambros. E 18 inf., de Bergame, de S. Simplicien et enfin du cod. Ambros T. 120 sup.. Il a fait mention de plus – sans en tenir compte pour son édition – des trois autres sacramentaires ou missels de Monza, de Robert Visconti, et d’Armio. Sa nomenclature comprend donc douze manuscrits seulement, à la plupart desquels, avec une touchante et un peu naïve affection pour son rit, il attribuait une antiquité vénérable, majorée dans certains cas d’un bon siècle.
En 1939, Don Ernesto Moneta-Caglio3 (1907-1995) publia dans son ouvrage sur « la messe ambrosienne et sa pastorale liturgique » une liste de 29 missels ambrosiens manuscrits, tous conservés dans les quatre bibliothèques milanaises citées ci-dessus, soit un chiffre double de celui de Ceriani, et triple de ceux de Delisle et Lejay. Il a toutefois volontairement ignoré tous les missels conservés ailleurs qu’à Milan.
En 1950 enfin, Pietro Borella publia un important répertoire « Saggio di bibliografia del rito ambrosiano » aux Archives ambrosiennes, en précisant qu’il pouvait être « développé et perfectionné. » L’abbé lyonnais Robert Amiet (1912-2000) l’a pris au mot et entrepris dans les années soixante du vingtième siècle une étude historique des livres ambrosiens, réalisant une synthèse qu’il a considérée comme un inventaire exhaustif des 37 sacramentaires et missels ambrosiens manuscrits qui sont parvenus jusqu’à nous, dont deux missels (les n° 15 et 37 de sa nomenclature) qui avaient totalement échappé jusqu’ici à l’attention des érudits. Elle se déroule du plus ancien au plus récent connus, couvrant donc les exécutions manuscrites du début du XIe au milieu du XVe.
La plupart de ces manuscrits sont conservés à la Bibliothèque ambrosienne de Milan :
- Le Sacramentaire de Biasca de la fin du IXe siècle, porté à l’Ambrosienne en 1776 « Ex ecclesia S. S. Petri et Pauli quae est Abiaschae, metrocomia in Lepontiis »4. Le parchemin a fortement jauni, tant du fait de sa vétusté que de son long usage à l’autel. Il se compose de 312 feuillets, mesurant très exactement 204 x 281 mm, et plusieurs copistes se sont partagé la tâche de le calligraphier à longues lignes, a raison de 25 lignes à la page, sans aucune ornementation. Sa reliure de cuir est moderne, exécutée à Modène en 1956 (cod. A 24 bis Inf.).
- Les Sacramentaires de Trotti (cod.Trotti 251° et de Lodrino (cod. A 24 bis inf.). « ex ecclesia Lodrini in Lepontiis » de la première moitié du XIe siècle.
- Sacramentaire ambrosien du XIe, (cod. T 120 sup)
- Le sacramentaire de Bedero du début du XIIe
- L’Ordo de Berold « ordo et caeromoniae ecclesiae ambrosianae mediolanensis ». Ms. cod. 1152 inf. XIIe siècle
- Le sacramentaire de Robert Visconti.
- Missel ambrosien, XVe (B.A. Milan) E 18
- Le Missel de Blanche-Marie Visconti, v. 1450, A 257
- Le Missel de Desio, 1463, H 269
- Le Missel de S. Barnabé, 2ème moitié du XVe siècle A. 262ae
- Miscellanée ,cod. L. 100, XVe siècle
Bibliothèque Trivulzienne
Elle conserve un Missel ambrosien de la deuxième moitié du XVe siècle (A 17), le missel festif de Blanche-Marie Visconti, (E 34, v. 1435) et le missel votif de Brichino, (cod. F 8, 1439).
Bibliothèque du Chapitre
Elle est la mieux dotée après la bibliothèque ambrosienne : sacramentaire d’Héribert ou de Saint Satyre (première moitié du XIe siècle, cod. II.D.3.2.), le Sacramentaire de Saint Simplicien5 (XIe, cod. II.D.3.3), le sacramentaire d’Armio (XIe, cod. II.D.3.1.), deux sacramentaires de Sainte Thècle (1402, cod. II.D.I.1.), le Missel de S. Gothard (deuxième moitié du XVe. Cod. II. D. 2. 31.), le missel de Saint Barnabé (deuxième moitié du XVe, cod. A 262 inf.), un missel ambrosien festif (fin XVe, cod. II.D.1.3.) un Missel des défunts, cod. II D.2.29, 1506 et l’exceptionnel Missel du cardinal Arcimboldi (archevêque de Milan de 1488 à 1497), (1494, cod. II.D.1.13.) de 499 folios en format 288 mm X 403mm, décoré d’une profusion de lettrines miniaturées.
Bibliothèque Brera
Missel de S. Stefano in Brolio, (v.1450, cod. AG.XII.3) et le missel festif de l’archevêque Filippo Archinto, 1557.
Chapitres de Vercelli et Monza : ces deux villes du Piémont italien conservent chacune un sacramentaire du XIe siècle.
Archives de la Basilique Saint Ambroise
La pièce maîtresse conservée à Saint Ambroise est le Sacramentaire de Jean Galeas Visconti, 1395 et un Sacramentaire ambrosien, (deuxième partie XIe, Codex M 17). Six antiphonaires provenant de l’église S. Maria di Crescenzago, plus tardifs (fin XVe) présentent de riches enluminures réalisées par des artistes lombards6 pour le prévôt de cette église et son successeur, Federico Sanseverino, devenu Cardinal en 1492.
Autres lieux hors de Milan :
La bibliothèque centrale de Zurich détient le Sacramentarium Triplex(ms. C 43). D’un intérêt liturgique considérable, il est, selon Dom Cagin, la copie réalisée au IXe siècle, à St Gall, d’un archétype plus ancien : un sacramentaire du VIIIe siècle, révisé en compilant les trois traditions gélasienne, ambrosienne et grégorienne, respectivement notées G, A ,et GG. – d’où son nom de sacramentarium triplex.
En Italie, la bibliothèque vaticane de Rome conserve le Sacramentaire de Saint Maurille de 1347 (cod.Palat.lat.506) et le Sacramentaire de Bergame, (XIe, cod.242) provenant de cette ville, entreposé à la B.V. par sécurité pendant la deuxième guerre mondiale après avoir été dérobé en 1939 à la bibliothèque Saint Alexandre par un employé peu scrupuleux puis rendu à l’évêché de Bergame. La bibliothèque capitulaire de Lucques possède un codex du XIe (cod.605) « ad consecrandum ecclesiam et altaria ».
Le British Museum de Londres abrite le deuxième sacramentaire de S. Simplicien (XIe, ms. Harleian 2510), découvert au XXe siècle sur un manuscrit palimpseste par Dom Odilo Heiming.
Enfin, la bibliothèque nationale de Paris détient un missel ambrosien de la deuxième moitié du XVe siècle (ms.lat. 856), dans un excellent état de conservation mais à la décoration modeste.
- Satyre était le frère d’Ambroise de Milan↥
- « Missale ambrosianum duplex », A. Ratti et M. Magistretti, Milan 1913) ↥
- Directeur de l’Institut ambrosien de musique sacrée et de la bibliothèque du Chapitre de Milan, maître de chapelle de la cathédrale de Milan et fondateur du Chœur ambrosien. Petit-fils d’Ernesto Teodoro Moneta Caglio (1833-1918), titulaire du seul prix Nobel de la paix italien, à lui décerné en 1907.↥
- Petite ville de la haute vallée du Tessin suisse. Lepontiis : peuple des Alpes (César, De bello gallico, IV, 10.) ↥
- Évêque de Milan, successeur de Saint Ambroise.↥
- Artistes anonymes, parmi lesquels le plus talentueux (peut-être un chartreux de Pavie) est nommé par convention « le maître de Crescenzago ». Crescenzago est aujourd’hui un quartier de Milan.↥